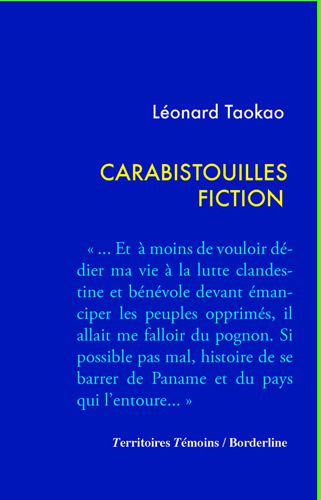« Sur les pas de mon frère » Pierrick
Gazaignes
Collection Dépendances ETT Éditions Territoires témoins
www.territoirestemoins.net
5 avril 1953. Au Sud de Luang Prabang (Laos).
Vers 11h00 du matin.
J’ai attaché au bout du canon de mon PM le petit foulard
qu’elle m’a donné. Verdier et Demaison se sont foutus de ma
gueule mais comme ils savent que quand je dis plus rien et que
mon menton tremble, je suis prêt à rentrer dans le lard de
n’importe qui, ils ont tout de suite arrêté.
On marche dans la jungle depuis trois jours. On est en
opération. Les deux éclaireurs viets qui sont avec nous sont aussi
bons marcheurs qu’ils connaissent le terrain. Sans eux et le
lieutenant, on aurait été taillés en pièces depuis longtemps.
J’ai appris au cours de ces longues semaines à survivre. Comme
un animal. Je suis un animal. Je sens comme un animal. Je sais la
peur qu’il éprouve, je la sens au fond de moi et c’est cette peur
instinctive qui, je sais, me permet de rester en vie. C’est la seule
chose que j’ai comprise sans doute parce que ça répond à une sorte
de pulsion. Il y a pourtant deux trucs qui me font mourir de peur
tout le temps. La première c’est que je ne sais jamais où on est et
la deuxième c’est que je sens en permanence que cette saloperie de
Vietminh peut nous tomber dessus à n’importe quel moment.
- Eteins ta clope Simon.
- Lieutenant, il va nous faire dézinguer si vous lui faites pas
avaler son mégot.
- Ta gueule Fratus, je l’écrase ma tige.
- Ils sont loin devant ? a demandé le lieutenant Salva.
En tête de colonne quelqu’un a gueulé :
- Ça fait un moment que je les ai pas vus mon lieutenant.
- Ils ont combien d’avance sur nous Régis ?
- Cent mètres.
- Putain, c’est trop mon vieux, t’as vu comme c’est dense dans le
coin, faut que tu ailles me les chercher.
J’ai resserré la jugulaire qui retient mon chapeau de brousse. Les
feuillages tropicaux formaient comme un toit au-dessus de nos
têtes au travers duquel le soleil lançait des faisceaux de lumière de
plus en plus disséminés. L’impression d’étouffement était renforcée
par la chaleur abominable et moite. Ecrasante. J’ai glissé le mégot
de ma clope dans le paquet à moitié écrasé que je faisais tenir au
filet de mon chapeau à bord.
- Bouge ton cul Dinard, fais moi revenir les Viets dans la
colonne, a crié le lieutenant.
- Seul, mon lieutenant ?
- Dépêche-toi de tracer, ils vont prendre trop d’avance.
Ça m’a étonné que le lieutenant lui dise de partir seul. C’était
pas son genre. Moi je savais que c’était un gros risque de le laisser
partir seul. Il était pas dans son assiette le lieutenant depuis
quelque temps. Il a levé son PM au-dessus de sa tête, l’a fait
tourner en l’air. C’était le signe que tout le monde devait s’arrêter
de marcher. Les quinze qu’on était, on s’est assis où on pouvait de
part et d’autre de la piste qui s’était rétrécie au point de pouvoir à
peine laisser passer un seul homme à la fois. Dinard a décroché son
sac à dos, a ôté son chapeau pour éponger la sueur qui trempait ses
cheveux comme s’il venait de prendre une douche.
Il n’avait pas l’air d’avoir la trouille, on aurait dit qu’il allait
partir comme un gosse à l’exploration d’un bosquet. Tous les mecs
de la section le regardaient. Il a réajusté son chapeau. Aucune
expression sur son visage. Le lieutenant lui a mis la main sur
l’épaule.
- Attends Dinard… le lieutenant a mis ses mains en porte-voix
devant sa bouche et a crié, b!n có tr"#c $%n nay ? (vous êtes loin
devant ?)
On a tous attendu une réponse mais rien ne nous est parvenu.
Il a repris.
- B!n $ang quá xa t#i! d&ng ! (Vous êtes trop loin devant !
arrêtez !).
Le lieutenant a regardé Dinard. Il fallait qu’il y aille.
Dinard n’a même pas jeté un regard vers nous. Il s’est engouffré
dans les herbes épaisses qui l’ont fait disparaître au bout de
quelques mètres de nos champs de vision.
Presque tous les gars ont fait mine de prendre une clope dans
leur sac, sur le paquet attaché à la poche de leur chemisette ou à
leur ceinturon. Le lieutenant a fait signe que non. Personne n’a
moufté. On ne disait plus un mot. On entendait le cri d’une sorte
de coucou qui répondait aux hurlements de singes déchaînés qui
sautaient de branches en branches au-dessus de nous.
- C’est pas une connerie de le laisser aller tout seul lieutenant ?
j’ai demandé.
(…)
9 septembre 1953. Etang de Bages (Aude)
Il faisait frais pour un mois de septembre. J’avais été relever les
nasses seul. Maman ne se sentait pas bien et je crois que c’était la
première fois qu’elle me l’avouait. C’est dire si elle n’était pas en
forme.
Depuis que Simon était parti ça n’avait pas aidé à la faire revenir
parmi les vivants. Trois ans plus tôt il y avait déjà eu l’accident de
papa et ça avait été le début de la fin. Maman n’était plus la
même. Et pour tout dire, il me semble que c’était pas la mort de
papa qui l’avait le plus affectée. Elle l’avait même plutôt pas trop
mal encaissée. Si on peut dire les choses ainsi… Par contre, quand
Simon est parti, alors là, tout s’est mis à foutre le camp, on aurait
dit qu’elle avait tout de suite compris qu’elle ne pourrait pas s’en
remettre. Et la vie d’avant n’est plus jamais revenue…
Pendant quelques mois, en fait jusqu’à son départ de Bages, j’ai
voulu croire que ça pourrait s’arranger mais j’ai fini par
comprendre que c’était irréversible. Avec sa décision de s’engager,
Simon avait donné raison à maman qui n’arrêtait pas de dire que le
destin s’acharnait sur nous.
Quand papa a eu son accident, je me suis raccroché à mon frère
comme à une bouée de sauvetage. Je l’avais toujours énormément
admiré mais à la mort de papa c’est devenu mon seul modèle. Ma
seule référence. Je savais que c’était lui qu’il fallait que je suive. Je
savais que j’aurais pu mourir pour lui. Peut-être plus encore que
pour maman.
Tout ce qu’il faisait me paraissait formidable. Tout ce qu’il
faisait était formidable. Il aurait pu faire les pires conneries j’aurais
trouvé ça incroyable.
Mais mon frère ne faisait pas de conneries. Il était calme. Il
réfléchissait avant de faire les choses. Il ne s’emportait jamais. Ses
sentiments ne sortaient jamais vraiment de lui. Enfin… je ne sais
pas comment dire, là-dessus il était totalement l’opposé de moi.
A la mort de mon père par exemple. Il n’a pas pleuré. Tout le
monde pleurait au cimetière parce que je pense que tout le monde
aimait mon père. Mais lui il n’a rien dit. La seule chose dont je me
souvienne c’est qu’il était très pâle et que quand on a descendu le
cercueil dans le caveau son menton s’est mis à trembler. Et
pourtant il n’a pas versé une larme. C’est même lui qui soutenait
maman et qui me disait de ne pas chialer comme une fille.
J’ai toujours voulu lui ressembler mais je savais que je n’y
arriverais pas. Je parlais tout le temps et je lui posais toujours des
questions. Lui, au contraire, pesait tous les mots qu’il disait. Il ne
se précipitait pas comme moi et c’est exactement ce que j’aurais
voulu pouvoir faire.
Il ressemblait à maman pour ça et je sentais qu’ils n’avaient pas
besoin de beaucoup parler pour se comprendre. J’étais toujours
pendu à elle quand j’étais petit. Lui pas. C’est maman qui me
l’avait dit après qu’il soit parti là-bas.
Ce matin-là quand je suis rentré à la maison, j’ai été surpris de
voir le portillon du jardin ouvert. Maman le tenait fermé pour ne
pas laisser s’échapper Rancoule, notre chien.
Comme elle ne se sentait pas bien je me suis dit que le facteur
était sans doute passé et qu’il avait oublié de le refermer. J’ai
déposé la bassine pleine d’anguilles sur le perron et suis entré dans
la maison. J’ai appelé mais personne n’a répondu.
Sur la table de la cuisine, il y avait toujours le petit déjeuner que
j’avais laissé en plan le matin même et que maman n’avait pas
débarrassé. A côté une enveloppe. J’ai tout de suite compris ce
qu’elle contenait. Elle n’avait pas été décachetée. J’ai hésité en me
disant que c’était à maman de le faire, mais je n’ai pas pu attendre.
J’ai rapidement survolé les premières lignes pour arriver au fait
lui-même. Je sentais une boule me serrer la gorge et des larmes qui
coulaient sur mes joues. Je devais les essuyer pour y voir quelque
chose mais rien ne pouvait les empêcher d’envahir mes yeux.
Votre fils… Simon Rozier… disparu en opération… n’ayant pas
donné signe de vie depuis… Tout porte à croire que … dans une zone
d’affrontements sauvage particulièrement difficile d’accès… Nous avons
le regret de … Nous vous prions de … l’armée française… saluons le
courage et la bravoure de votre fils … fait don de sa vie pour de notre
République… au nom de…
J’ai senti que les larmes s’étaient arrêté de couler. J’ai senti
qu’un sentiment que je ne connaissais pas se répandait en moi
comme un poison. J’ai regardé autour de moi le vide de la cuisine.
J’ai lâché la lettre qui est tombée comme une feuille morte à mes
pieds. J’avais envie de hurler mais aucun son ne pouvait sortir de
ma bouche. On aurait dit qu’une main de fer invisible garrottait
ma gorge pour empêcher la souffrance de sortir de moi.
Maman est apparue dans l’encadrement de la porte de la
cuisine. Je n’ai pas pu la regarder dans les yeux. Je n’ai pu que fuir.
Je n’avais qu’une envie : le rejoindre.